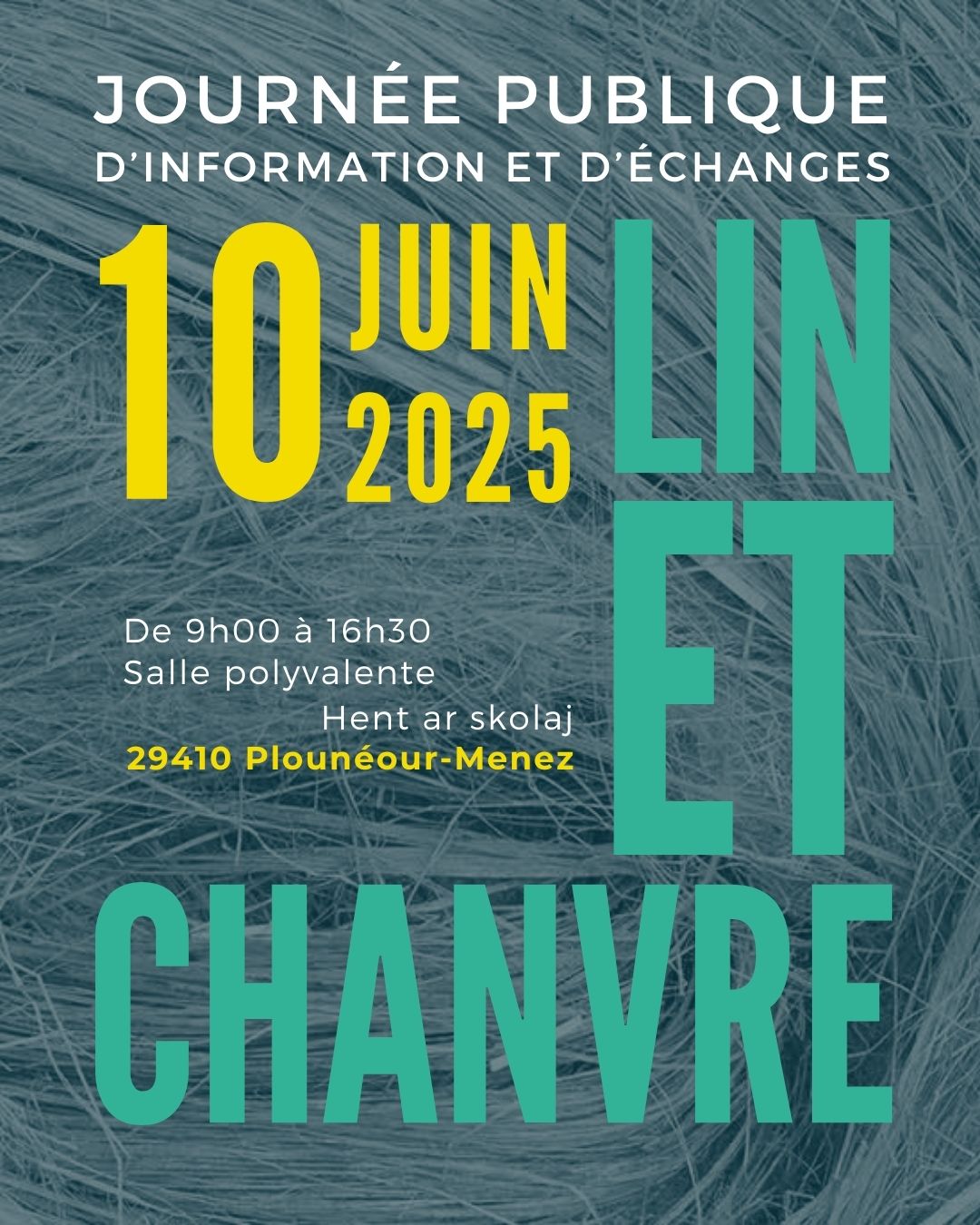Le plan algues vertes
Après plus de 10 ans de plans de lutte contre les algues vertes, après des rapports très critiques, et de la Cour des comptes, et du sénat en 2021, après un jugement et des injonctions du tribunal administratif en juin 2021, avons-nous enfin un plan de lutte contre les algues vertes efficace, qui s’attaque à la racine du problème pour l’éradiquer ?
Posons un préalable : l’ultime échéance du bon état écologique des eaux bretonnes est fixée par l’Europe pour 2027.
Pour juger de ce plan, il faut déchiffrer la vision du développement agricole qui l’inspire.
Et c’est là que le bât blesse. Dans ce plan, on nous parle d’une agriculture qui doit éviter les fuites d’azote. A partir de cette vision, les mesures sont déclinées : les travaux sur les fermes pour assurer l’imperméabilité des équipements de stockage du lisier, des pratiques culturales de couverts végétaux ou de rotation de cultures pour fixer l’azote ou la restauration des zones humides et le bocage pour dénitrifier avant que l’eau n’arrive à l’exutoire chargée d’azote.
Toutes ces mesures concrètes sont nécessaires mais elles ne suffisent pas. Elles restent de l’ordre du curatif tant qu’elles ne sont pas inscrites dans une autre vision du développement agricole : celle d’une agriculture liée au sol, une agriculture dimensionnée aux capacités des sols et de l’eau.
Il s’agit aujourd’hui de changer enfin de paradigme, de sortir d’une logique de réduction des fuites d’azote pour s’inscrire dans une logique de réduction des apports en azote (engrais minéraux, les lisiers, les fumiers)
Ce qui permet d’assurer d’une agriculture dimensionnée aux capacités des sols, c’est le principe de l’autonomie sur les fermes.
Il nous faut des fermes autonomes, tout d’abord, en matière d’alimentation des animaux d’élevage et non pas dépendantes du soja brésilien, lequel constitue une catastrophe sur le plan climatique, mais qui donne en outre à la Bretagne une surcapacité en protéines végétales … pour nourrir de fait du bétail en surnombre.
Faut-il rappeler que les algues vertes proviennent à plus de 90 % des nitrates agricoles, qui eux –même proviennent de l’excédent d’azote ?
Faut-il rappeler que l’azote est le produit de la dégradation des protéines ?
Et que donc trop de protéines, c’est trop d’azote organique, ce sont des nitrates en excédent, et ce sont des algues vertes qui se répandent en marées sur notre littoral !
Le second versant de l’autonomie des fermes, c’est l’autonomie en engrais, c’est à dire la réduction de la dépendance aux achats d’engrais azoté minéral, lequel azote minéral vient s’ajouter à l’azote organique pour augmenter l’excédent d’azote global.
Ce sont ces principes d’autonomie et de dimensionnement avec les capacités des sols bretons, cette approche systémique et cette prise en compte du cycle entre animaux et culture qui auraient dû être au cœur de la définition de ce nouveau plan. Or, ce n’est pas le cas !
L’État, qui pourtant détient les pouvoirs législatifs, règlementaires et financiers, ainsi que le pilotage de l’ensemble de la PAC ne prend pas ses responsabilités.
Car s’il n’y a pas à déresponsabiliser la profession agricole, il n’y a pas non plus à la sur-responsabiliser en s’abstenant de créer les conditions du changement, notamment ses conditions rémunératrices.
Pour ce qui concerne les propositions de la Région, nous soutenons la démarche de la majorité quant à l’éco-socio-conditionnalité et aux exigences de conventionnement avec la SAFER.
Nous demandons cependant à voir la déclinaison concrète de ces objectifs, et ceci nous renvoie aux futurs débats politiques sur ces sujets.
Nous fustigeons donc le fait que les transitions agricoles soient pensées au travers du seul paradigme de la réduction des fuites d’azote et que ce paradigme se reflète dans tous les leviers régionaux, que ce soit l’accompagnement des territoires, le pilotage du PCAEA (Plan de Compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) ou le regard sur l’installation des jeunes agriculteurs.
En particulier, nous regrettons que la gouvernance de ce plan n’associe pas suffisamment les élus locaux et les acteurs associatifs, ces derniers s’estimant dès lors instrumentalisés, voire méprisés. Un minimum de recul sur l’analyse de la situation aurait conduit à une stratégie systémique de lutte contre les algues vertes, sur tout le territoire breton, avec une attention spécifique aux bassins versants les plus touchés.
Nous avons urgemment besoin d’un nouveau récit agricole et alimentaire. A cet égard, nous espérons que la Région Bretagne accueillera favorablement la proposition portée par certaines associations, de mettre sur pied une plateforme multi-acteurs, qui se réunirait à intervalles réguliers afin de construire ce nouveau récit collectif, mais aussi et surtout pour mettre en mouvement l’ensemble des acteurs – comme cela a été le cas dans les 1960 – pour construire le nouveau modèle agricole breton.
En attendant, chers collègues, le groupe Breizh a-gleiz ne se satisfait pas des orientations aujourd’hui sur la table, lesquelles, encore une fois, éludent la racine du problème.
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
6 juillet 2025
6 juillet 2025
6 juillet 2025