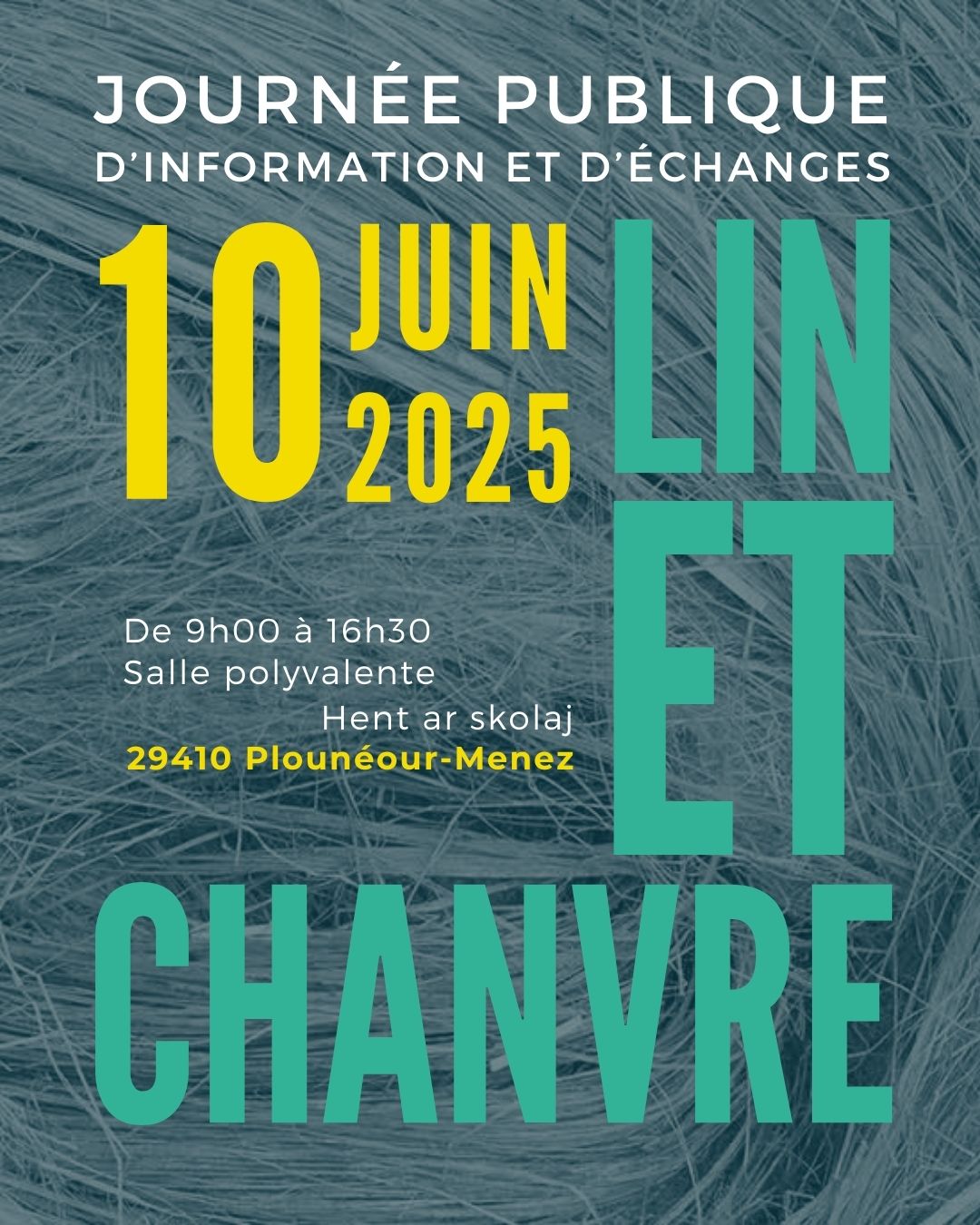La carte pluriannuelle des formations professionnelles
En préambule : saluer l’opportunité que cette discussion sur la « carte pluriannuelle des formations professionnelles sous statut scolaire » nous offre de réaffirmer avec force la valeur de ces formations professionnelles et des métiers auxquels elles ouvrent
L’introduction du bordereau dresse le constat d’une baisse globale des effectifs dans ces formations, auquel la réforme de l’apprentissage « ne serait pas étrangère » (transferts d’effectifs depuis la formation professionnelle initiale sous statut scolaire vers l’apprentissage). Certes… Mais la déconsidération dont pâtissent trop souvent les filières professionnelles nous renvoie aussi à un problème culturel plus profond : problème de « culture scolaire » valorisant trop exclusivement les compétences de type académique (système qui « casse » de nombreux enfants, auxquels l’on inculque précocement que leurs résultats scolaires les condamnent à n’être « que des manuels », et donc un système qui produit du ressentiment social à long terme) ; problème plus vaste d’une culture nationale française qui entretient une passion trouble avec la figure de l’intellectuel.
Toujours est-il que ce bordereau qui concerne une compétence régionale majeure, et sur un sujet de société si important – à un carrefour historique où le mantra de la réindustrialisation est sur toutes les lèvres, où les fractures sociales et territoriales tournent au vinaigre – aurait du être l’occasion de formuler quelques éléments quelques éléments d’un récit régional inclusif et mobilisateur sur le travail. Un discours qui rompe avec les conceptions hiérarchiques et si préjudiciables entre travail de conception (travail de la tête) d’une part, et travail d’exécution (travail de la main) d’autre part. Car de la même manière que nous avons besoin d’un nouveau récit, et d’un nouvel imaginaire, de l’industrie, nous avons aussi besoin, et même encore plus, d’un nouveau discours sur le travail.
Citer Simone Weil pour décrire le travail, dans son double versant, manuel et intellectuel : activité porteuse de sens et vecteur de cette capacité singulière qu’a l’homme d’entrer en prise avec le monde et ses mutations. Tout l’enjeu pour notre institution régionale : contribuer à faire du travail un lieu d’émancipation pour les Bretonnes et les Bretons, et cela commence par les valeurs, le sens, aussi bien que par les compétences forgées pendant le temps crucial de la formation professionnelle.
Ceci étant dit, je voudrais vous soumettre, Mme la Vice-Présidente, chers collègues, trois remarques et autant de questions :
• 1e remarque (qui aura été soulevée par tous) : relever la méthode de concertation et de dialogue ayant présidé à l’élaboration de cette carte
Processus engagé depuis l’été 2023 : au niveau régional avec les représentants professionnels (dans prolongement de la concertation organisée dans le cadre du CPRDFOP) et au niveau territorial à travers la mobilisation des Commission Territoriales Emploi Formation, les CTEF (plus précisément : autodiagnostic par les établissements, concertation territoriale au niveau des CTEF impliquant les établissement afin d’avoir un diagnostic partagé, concertation avec les branches professionnelles)
• 2e remarque, dans le sillon de l’intervention de Valérie Tabart sur le PRIC : on cherche en vain dans ce nouveau dispositif pluriannuel une véritable impulsion prospective
Le passage à la pluriannualité est censé favoriser une transformation structurelle de l’offre, non seulement au regard des évolutions du monde du travail mais aussi en lien avec « les mutations économiques, sociales et environnementales », lesquelles ne sont pas caractérisées plus avant que cette formulation générique. Faire allusion à la QO de Christian, sur un domaine, l’IA, qui amène une véritable révolution (relations homme/machines)
Trois priorités sont posées, mais l’exercice d’anticipation stratégique tourne court :
– Formations industrielles (nous avions dit notre accord, lors de l’adoption de la SRTES) mais on aimerait un peu d’anticipation. Donner l’exemple des 2 « formations nouvelles » prévues dans les « industries de process » (plasturgie, matériaux composites) : aucune allusion aux perspectives de substitution des dérivés des hydrocarbures, alors que R&D est en cours (cf Faurecia) ; et le lien n’est pas fait avec les transitions énergétique et environnementale
– BTP et énergie : cf éco-construction
– Formations sanitaires et sociales : affichées comme une priorité, en cohérence avec évolutions démographique (vieillissement tendanciel), pourtant aucune ouverture de formation n’est prévue dans ce domaine
• 3e remarque, qui concerne le plus directement la nature du document, que s’annonce comme « une carte », et qui devrait donc nous permettre d’apercevoir le panorama global des formations professionnelles initiales sous statut scolaire : or sans cartographie des fermetures, la moitié du paysage nous échappe !
– Pas d’articulation avec l’apprentissage
– Surtout : puisque le cadre fixé par l’État est celui d’une constriction des moyens et d’un nombre constant de formations professionnelles dans les lycées publics, sans visibilité sur les fermetures de formations, tout diagnostic global est impossible. Il apparaît a fortiori délicat de jauger du véritable impact des efforts en matière de territorialisation de l’offre (cf ambition d’aménagement du territoire)
>>Il n’est pas possible de se satisfaire de ce jeu à somme nulle dans lequel il manque l’un des deux termes nécessaires à la résolution de l’équation !
• En découle une 1e question : Mme la Vice Présidente, attendez vous donc que nous rejouions le débat d’aujourd’hui dans six mois, lorsque vous serez en mesure de nous présenter les données sur les fermetures de formation ?
◦ De surcroît : interroger sur formations agricoles (dans le contexte d’un parcours législatif incertain pour la LOA)
• 2e question, sur la méthode à venir : quels moyens d’animation afin de garantir la mobilisation, tout d’abord, des établissements, mais aussi, et dans la durée, de la pluralité des acteurs (branches professionnelles, entreprises, etc) à l’échelle de chaque territoire breton ? Et quels outils de suivi et d’évaluation de l’effectivité du dispositif ?
• Enfin et 3e : un faisceau de questions se rapportant à l’ambition (louable) d’aménagement du territoire affichée dans la carte des ouvertures (24 ouvertures sur 48 ont l’aménagement du territoire comme principal justification) :
◦ Clarifier la contradiction entre constat de polarisation autour des grands pôles urbains et ambition de rééquilibrage géographique d’une part, et volonté de remédier à la situation de pénurie d’offre sur le bassin rennais en ouvrant 4 formations dans ce territoire d’autre part
◦ Clarification terminologique : différence entre « aménagement du territoire » et « rééquilibrage territorial de l’offre »
◦ Quelles sont les mesures complémentaires envisagées afin de remédier aux problématiques de logement et de mobilité d’un public lycéen peu mobile ?
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
1 juillet 2025
1 juillet 2025
1 juillet 2025