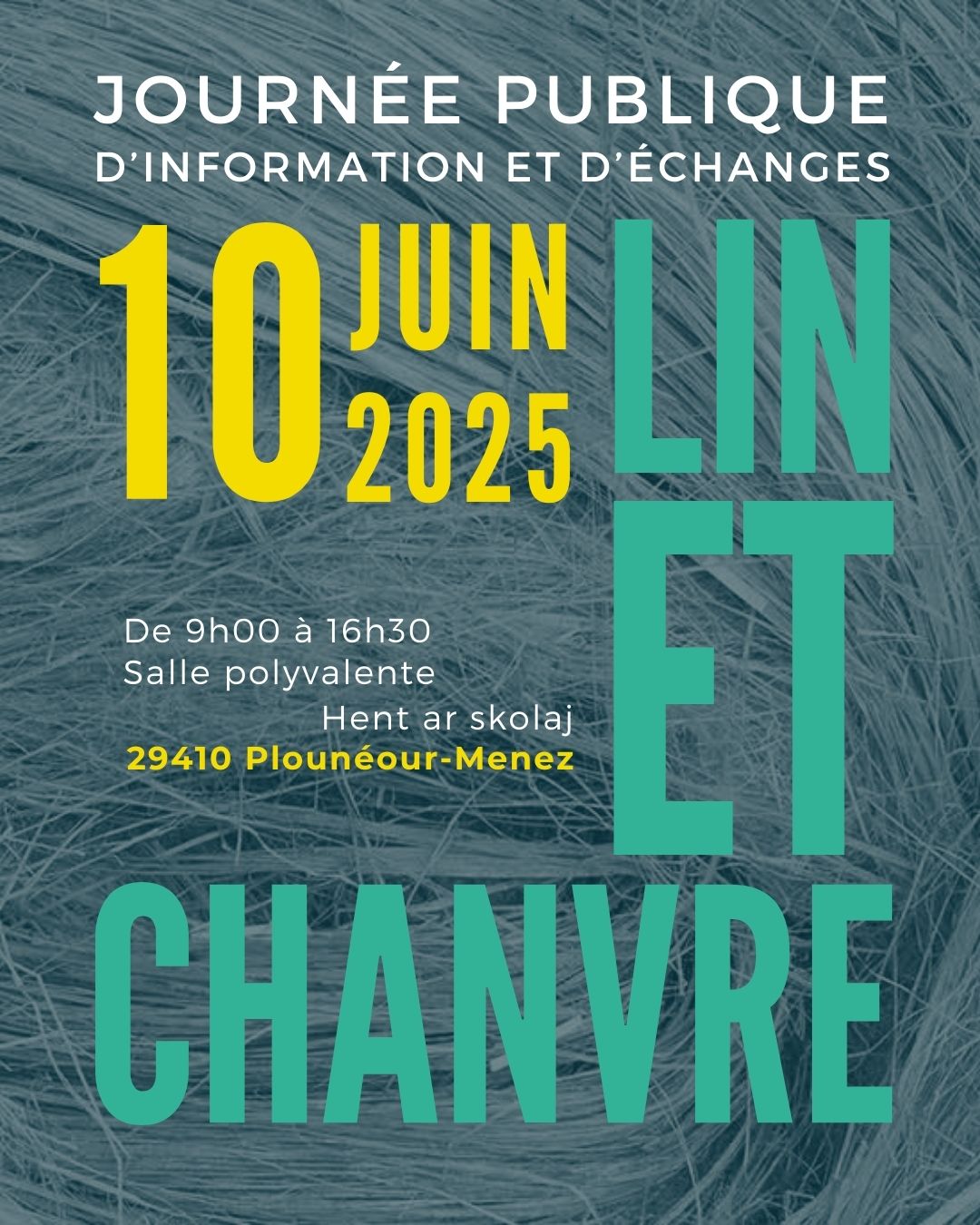Le débat budgétaire – Economie et innovation
La politique d’innovation de la Région Bretagne s’articule autour des programmes 503 et 504. Le premier est le pivot de cette politique, le second cible les secteurs stratégiques sur ce volet de l’innovation.
Reconnaissons-le, la rédaction du rapport du programme 503 est entièrement consacrée à la transformation de la S3 au vu des objectifs de la SRTES. De ce point de vue, Mme Fortin, nous devons dire que vous vous êtes sérieusement essayée à l’exercice promis au moment de l’adoption de cette stratégie globale, qui articule les différentes dimensions de la nécessaire mutation de l’économie bretonne.
« Accélérer », « mobiliser », « consolider » – vous n’y allez pas avec le dos de la cuillère sur cette réorientation, et c’est tant mieux.
Mais reconnaissez-le aussi, il y a là, avant tout, un texte général d’intentions politiques et non de mécanismes précis de ré-aiguillage de vos politiques. Si ce texte vient à se concrétiser dès 2024, alors nous ne pourrons le vérifier qu’au cours des commissions permanentes qui ponctuent l’agenda régional entre deux sessions. Il est donc par principe délicat de reconnaître que l’objectif est atteint alors que nous n’en avons pas encore vu les déclinaisons.
Or, nous avons des points de comparaison plus probants sur d’autres politiques publiques. L’un de vos collègues les plus concernés par cette bifurcation, le Vice-président à l’agriculture, a eu des occasions de nous donner à voir des indices de ce changement, au travers de débats sur l’installation, le bio, ou d’un débat majeur que nous aurons vendredi. Vous-même, dans l’autre partie de votre délégation, nous avez présenté un programme « bien vivre » indiscutablement revisité à l’aune des enjeux de transition écologique et sociale.
Le mieux aurait sans doute été de nous présenter lors d’une des sessions qui précède celle-ci une délibération de réécriture des stratégies concernées, ou du fonctionnement de tel ou tel dispositif d’innovation. C’est cet exercice que nous attendions et qui ne s’est pas encore produit. Espérons qu’il viendra vite.
A ce stade, deux éléments de cette politique continuent de nous interroger. Sa géographie d’une part, voire son principe-même.
Au tout début du mandat, nous vous avions interpellée sur les projets accompagnés par les 7 technopoles bretonnes et leur implantation. Car la carte qui rendait compte de l’action de ces technopoles faisait apparaître d’importants déséquilibres, voire des zones blanches, dans les territoires ruraux, pourtant maillés sur le plan industriel, et même pour certains d’entre eux définis comme des Territoires d’Industrie, selon la nouvelle carte de ce dispositif national.
L’exécutif avait répondu en chœur que les autres politiques, aménagement du territoire, agricoles, pass-commerce, rééquilibraient l’ensemble.
Cependant si nous réalisions une évaluation indépendante de cette politique publique, il est peu probable que sa conclusion soit celle que vous nous proposez. Car au fond, ces 7 technopoles sont installées dans les aires urbaines, dépendent d’elles et traitent mieux ces espaces urbains que les espaces ruraux voisins. Est-ce si dur à énoncer et à remettre en cause ? Ne pourrait-on pas imaginer un geste fort de rééquilibrage territorial, pourquoi pas sous la forme d’un financement variable, partiel sans doute, en fonction de la qualité de la couverture territoriale de la technopole concernée ?
Notre conclusion est qu’il ne suffit pas de « poursuivre l’adaptation » de cette politique d’innovation : il faudrait la refonder à l’aune des enjeux de transition et d’aménagement du territoire. Cette refondation doit porter à la fois sur la stratégie globale et sur chacun des dispositifs. Cela peut prendre un peu de temps, c’est pourquoi il faut commencer sans tarder.
Enfin il est utile de clarifier ce que nous attendons de l’innovation, et de rappeler fermement que l’innovation n’est pas une fin mais un moyen. Aucun gain technologique ne constitue en soi un progrès. L’innovation technologique peut être utile à la Bretagne, mais elle peut aussi ne pas l’être du tout. Cela peut paraître évident, mais le préalable quand on entend mobiliser des crédits publics pour accompagner des projets d’innovation, c’est d’avancer sans fétiche.
Pour poser les termes de ce débat, rappelons qu’un des dispositifs d’innovation les plus en phase avec les enjeux de transition est le programme LEADER.
Vous reconnaissez dans ce bordereau trois formes d’innovation : technologique, organisationnelle et frugale. L’an dernier, le triptyque était légèrement différent puisqu’aux innovations technologiques et organisationnelles, s’ajoutaient les innovations sociales. On pourra regretter l’absence de référence cette année aux innovations sociales, comme si ces dernières étaient toutes prises en charge par ailleurs, au titre de l’économie sociale et solidaire. Mais passons.
L’inédit, c’est donc l’innovation frugale. Ce concept a une histoire et n’est donc pas à ranger dans la catégorie des formules creuses qui colonisent parfois le débat public.
Il introduit la frugalité dans sa dimension la plus concrète, au-delà de la seule logique de sobriété. Il s’agit donc de partir du besoin, de le comprendre, de le limiter au strict nécessaire, puis, sur cette base, de chercher à y répondre précisément, avec la réponse la plus sobre disponible.
Ma collègue Valérie Tabart a défendu cette nuance entre frugalité et sobriété dans le groupe de travail énergie, et il peut très bien s’appliquer aux enjeux d’innovation économique. Par conséquent, nous sommes parfaitement satisfaits que ce concept apparaisse à cette place, et nous espérons qu’il trouvera une efficacité concrète dans les choix des projets soutenus et accompagnés par le budget de ce programme.
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
4 juillet 2025
4 juillet 2025
4 juillet 2025