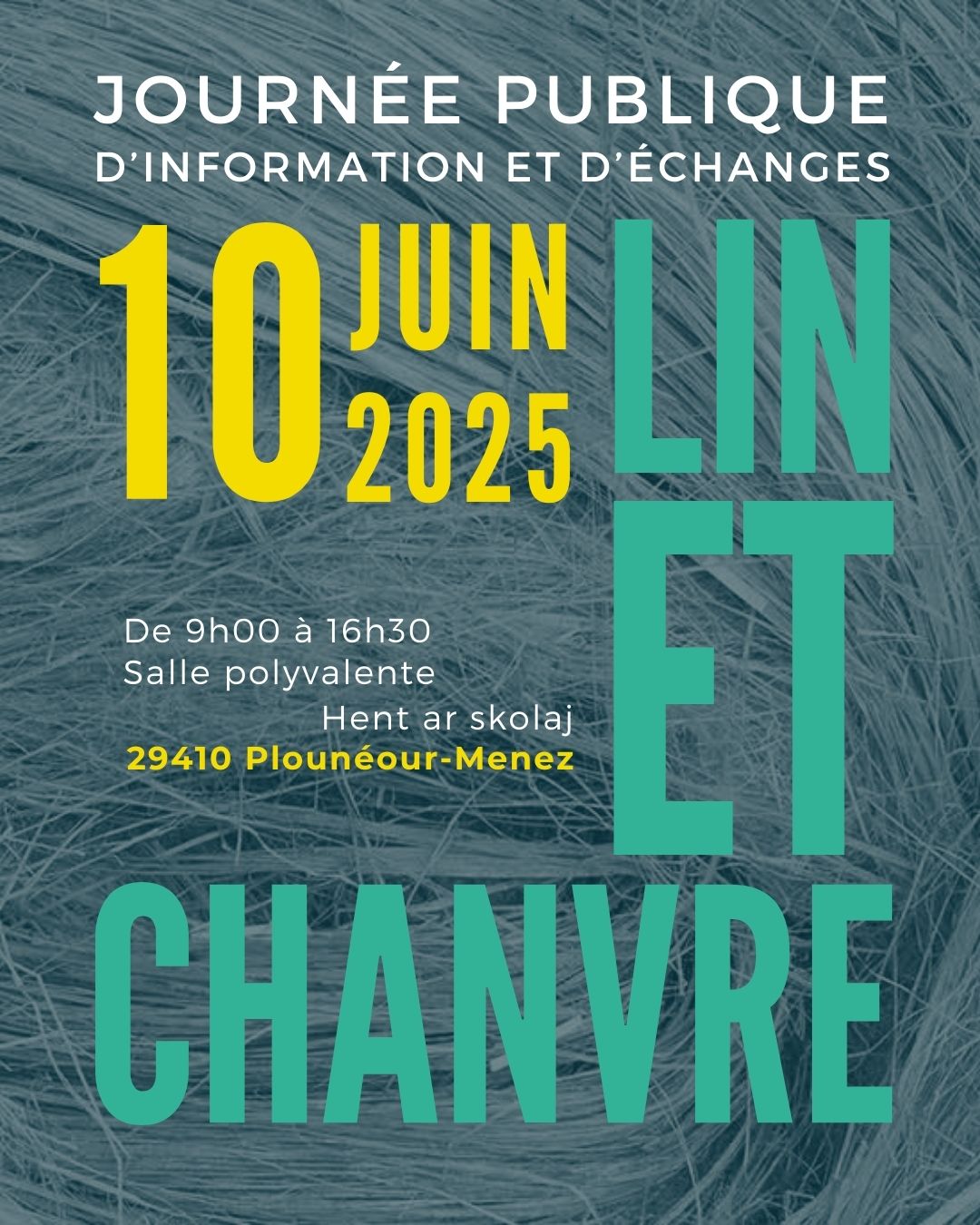Nos agriculteurs souffrent en Bretagne
Le début de l’année 2024 a été dominé par un débordement du «malaise paysan». Fondamentalement, nos agriculteurs souffrent d’être le réceptacle d’injonctions contradictoires. Sans doute parce que la fonction nourricière qu’assument les travailleurs de la terre tisse des liens intimes avec chacun de nous – des liens dans lesquels se logent toute notre reconnaissance, mais aussi la peur et l’opprobre, lorsqu’une salmonelle ou un prion introduisent la suspicion dans nos assiettes. Sans doute, aussi, parce que ce travail de la terre est investi d’une intensité culturelle particulière, que traduit le continuum sémantique entre «pays, paysan, et paysage».
Quelles que soient les affres de cette passion collective que nous entretenons avec nos paysans, les événements des dernières semaines nous laissent aussi un sentiment de malaise d’un autre ordre. Car sur l’expression d’un authentique désarroi du monde agricole se sont greffées des contrefaçons et de scandaleuses manipulations électoralistes. Et puisque cette session comporte une trame de sujets agricoles, le groupe Breizh a-gleiz a jugé utile d’ouvrir nos trois jours de débats par quelques mises au points, sans lesquelles nos échanges risquent de tourner aux tirs de caricature croisés, sans aucun intérêt pour les citoyens.
Commençons par rappeler les positions politiques des uns et des autres. Nous avons tout d’abord un Ministre de l’agriculture qui ose proclamer que la souveraineté alimentaire, c’est l’export. Et bien non ! Parce que la terre nourricière n’est pas une marchandise comme les autres, la souveraineté alimentaire se fonde sur la capacité d’une agriculture locale de nourrir sa population, et donc sur le droit à se protéger contre les importations qui introduiraient concurrence déloyale ou dépendances excessives dans les circuits alimentaires. Et si la focalisation de M. Fesneau sur l’export s’entend, dans un monde où les excédents commerciaux sont synonymes de puissance, il faut souligner l’imposture de cette définition de la souveraineté alimentaire.
Regardons maintenant ce qui se joue dans la politique commerciale européenne telle qu’elle est menée depuis deux décennies par une majorité de droite au Conseil et au Parlement européens : pour vendre des avions, des voitures ou des produits chimiques à ses partenaires extra-européens, l’Union a enchainé la signature de traités de libre-échange qui permettent l’importation, sans clauses miroirs, de contingents de viande échappant à nos normes sociales et environnementales. Les députés européens du parti de Mme Le Callennec et de M. Le Fur, comme ceux de Rennaissance, votent invariablement en faveur de ces traités. Le 24 janvier dernier encore, Mme Védrenne a déposé un bulletin « POUR » les accords commerciaux de l’Union avec le Chili et le Kenya. La droite, LR et Macronistes confondus, assume donc de prendre des positions à l’avantage des secteurs agricoles exportateurs – céréaliers, sucriers, géants du lait et viticulteurs – au détriment des agricultures vivrières des pays partenaires mais aussi de l’élevage familial breton, qui est le parent pauvre de cet affrontement des titans.
Le RN, quant à lui, assume beaucoup moins. Jordan Bardella a eu beau chausser des bottes immaculées, il ne saurait faire oublier que, contrairement aux socialistes et aux écologistes, les députés européens du RN ont voté «POUR» la dérégulation des prix portée par la nouvelle PAC 2023-2027 ; qu’ils ont également voté «CONTRE» un amendement d’octobre 2020 visant à plafonner les aides de la PAC à 60 000 euros par an ; et qu’ils se sont contentés de s’abstenir sur un autre amendement (écologiste) de 2020 visant à revisiter la politique commerciale de l’Union.
Les mêmes incohérences sont portées par M. Pennelle dans cet hémicycle, lorsque dans la même phrase, il déplore le recul du bocage tout en exaltant le productivisme exportateur. Ignore-t-il que l’export breton repose largement sur un cheptel élevé en stabulation, porcherie ou poulailler industriel, sans aucun rapport avec les prairies ? De telles positions traduisent, soit un court termisme électoral, soit une méconnaissance du monde de l’élevage.
Voilà l’autre sujet sur lequel nous voulons remettre l’église au milieu du village : l’élevage. Nous comprenons bien pourquoi M. Pennelle, vous voudriez voir en nous l’épouvantail de vos rêves, des wokistes à l’encéphalogramme altéré par des années de régime vegan ; malheureusement ce n’est pas le cas. Nous sommes tout sauf des ennemis de l’élevage. Et si je peux, pour une fois, parler de manière un peu personnelle, je vous dirai que mon rapport à l’élevage, avant d’être une conception élaborée politiquement, est d’abord affectif. Parce que j’ai grandi sur une ferme de vaches allaitantes. Parce que la maison de mon enfance était l’une de ces longères dans lesquelles nous rentrions, l’hivers, par l’étable, en effleurant de majestueuses blondes d’aquitaine qui étaient trop longues pour cette petite étable, ne nous laissant qu’un passage étroit entre elles.
Cette expérience est loin d’être unique. La relation entre l’homme et les animaux domestiqués – ce que mon grand-père appelait «les bêtes», d’un mot bien plus incarné et affectueux que celui de «vivant» – et bien cette relation entre l’homme et les bêtes est constitutive de la culture bretonne. Et nous saurons la défendre.
Mais là encore, il faut clarifier les termes du débat. Toutes les formes d’élevage ne se valent pas. Nous assumons de prioriser l’élevage bovin herbager, parce que cet élevage correspond aux qualités pédoclimatiques de notre péninsule atlantique et sa trame de prairies bocagères. Et nous assumons aussi de dire que l’élevage hors-sol, par ce qu’il génère de concentrations, de pollutions et de dépendances, n’est pas soutenable. Alors quand le débat agricole national tourne à la cabale contre un bouc émissaire unique – l’écologie – affublée de tous les oripeaux de l’agri-bashing – «culpabilisatrice», «décroissante», «punitive» – il faut savoir dénoncer les duperies.
Les fossoyeurs de l’agriculture, ce ne sont ni le Pacte Vert, ni le plan Ecophyto. Les vrais bradeurs de notre sécurité alimentaire, ce sont ceux qui prétendent que la réduction des pesticides ne serait pas une urgence absolue, pour la santé humaine, pour les interactions écologiques essentielles qu’assument les pollinisateurs, les oiseaux. Ceux qui préfèrent ignorer les études scientifiques et s’enferrer dans le déni sur la question de l’eau – ce sont ceux-là qui scient la branche sur laquelle repose notre agriculture.
Alors pour conclure, face aux inconséquences qui saturent aujourd’hui le débat agricole national, pouvons-nous, en Bretagne au moins, jeter des ponts salvateurs entre agriculture, écologie et débat démocratique ? Un débat démocratique qui ne pourra s’épanouir sereinement que s’il fait toute sa place à la science. Pouvons dire clairement que le cap de la transition vers l’agro-écologie n’est pas négociable, parce qu’il en va de notre souveraineté alimentaire, mais que le chemin, lui, est négociable ? Qu’il existe diverses manières d’articuler circuits longs et circuits courts, solidarité européenne et stratégies d’autonomie alimentaire à l’échelle de chaque territoire breton. Nous avons en Bretagne toutes les capacités de dialogue et de coopération requises pour poser les bases d’un nouveau contrat avec le monde agricole – d’un nouveau récit porteur de sens, de prospérité partagée et de concorde restaurée entre les hommes et leurs milieux.
Nous espérons que notre Région saura porter une voix claire dans ce dialogue.
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
1 juillet 2025
1 juillet 2025
1 juillet 2025