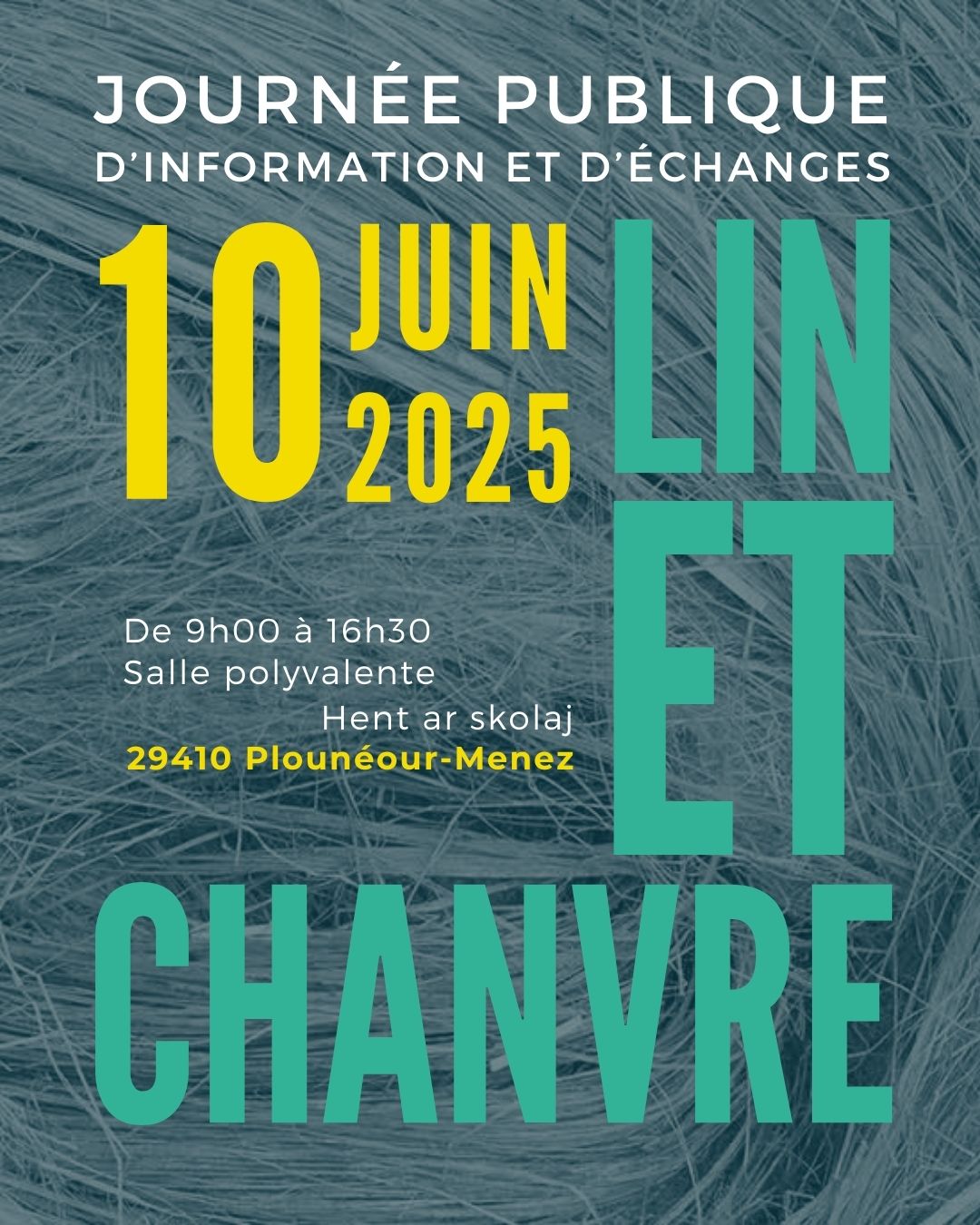Plan attractivité des lycées agricoles
Quelle bonne idée que ce plan d’actions en faveur de l’attractivité des lycées agricoles publics de Bretagne !
Oui, il faut rendre attractives et visibles les formations dispensées en lycées agricoles pour se donner les moyens de relever le défi du renouvellement de génération dans la reprise des fermes (la ½ à reprendre dans les 10 ans). Pour relever, aussi, le défi de la main d’œuvre dont l’agriculture bretonne a besoin, et aura encore davantage besoin demain si elle prend le virage agroécologique, comme elle a su prendre le virage productiviste dans les années 60.
L’enseignement agricole est donc attendu pour les mutations nécessaires à la Bretagne. Et il a des atouts considérables sur lesquels s’appuyer pour écrire cette nouvelle page, avec la jeune génération et aussi, de plus en plus, avec des personnes en reconversion.
L’enseignement agricole s’est toujours démarqué de l’éducation nationale par son ancrage territorial. C’est d’ailleurs l’une de ses missions.
Il se distingue aussi par sa pédagogie de projet, la capacité d’innovation des équipes enseignantes et par son lien au vivant, avec une ferme dans les établissements.
Un de mes plaisirs dans l’exercice de mon mandat de conseillère régionale est celui de participer à deux conseils d’administration d’établissements publics agricoles, celui de Caulnes et du Gros Chêne à Pontivy
Pour les collègues qui ne sont pas familiers de ces établissements, il faut rappeler qu’ils sont constitués de 4 entités, le LEGTA, lycée d’enseignement général et technologique ou professionnel, les CFPPA pour la formation continue qui entrent pleinement dans le champ de compétence de la région, les CFA qui, eux, relèvent de la compétence de l’Etat et l’exploitation agricole.
Faire cohabiter ces 4 entités, leurs logiques propres, leurs publics différents mais aussi les interactions entre elles est un exercice complexe mais aussi très riche de la vie de ces établissements.
Et cette vitalité est palpable, avec des questionnements, des réflexions qui émergent lors des réunions de conseils d’administration dans un dialogue avec les élus régionaux, les élus du territoire et les représentants de la profession agricole, qui participent activement aux réunions de Caulnes et Pontivy.
Saluer l’exception que constitue l’enseignement agricole dans le paysage éducatif, c’est aussi nommer le travail formidable d’inclusion de jeunes décrochés au niveau scolaire et « raccrochés » par la démarche pédagogique et le rapport au vivant.
La condition de réussite de ce plan d’attractivité des lycées agricoles tiendra dans le fait que chaque jeune breton dans son cursus de formation initiale ait bien en tête les différentes options qui s’offrent à lui : la voie de l’enseignement général ou professionnel, la voie de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, trop peu connue malgré ses atouts et sa force d’épanouissement pour un grand nombre de jeunes. Et cela vaut pour les 3 familles d’enseignement agricole en Bretagne.
Car si nous adhérons à un plan d’action en faveur de l’attractivité des lycées agricoles publics, nous attachons de l’importance aux échanges et à la coopération avec les 2 autres familles d’enseignement agricole, les lycées privés du réseau CREAP et les Maisons Familiales Rurales.
Je voudrais saluer la méthode de concertation, qui a ouvert les discussions à l’ensemble des acteurs, y compris les élus régionaux de la minorité.
Le résultat est intéressant : un plan d’actions, concret, opérationnel, non jargonneux , au plus près des besoins exprimés dans les ateliers et avec des sujets sensibles formulés sans tabou.
Ce dialogue riche et respectueux avec les équipes des établissements est un gage d’adhésion et de mobilisation pour la suite.
Cependant, si nous avions eu à conduire l’élaboration de ce plan d’action pour les lycées agricoles, nous aurions eu une autre approche.
Nous aurions notamment mis sur la table le sujet de la mutation agroécologique de l’agriculture bretonne, en rappelant les responsabilités collectives que nous avons en Bretagne : la réduction de l’empreinte carbone sur le territoire breton mais aussi sur les territoires que notre région impacte ; la qualité de l’eau et la sobriété de son usage ; les enjeux de santé environnementale, avec la sortie des pesticides, à l’horizon 2040 dans le SRADDET.
Nous n’aurions pas craint de plaider pour une agriculture redimensionnée à ses ressources, qui interroge le hors sol comme modèle d’avenir, qui interroge la place de la technologie.
Nous aurions donc posé sur la table une approche systémique de la production agroécologique, afin, notamment, de contrecarrer la tentation actuelle d’envisager les transitions agroenvironnementales à la carte, en travaillant ici l’eau, là l’énergie, ici la biodiversité. J’en profite pour redire notre soutien à la mobilisation actuelle, pour que l’Etat soit au RDV des MAEC, ces mesures agroécologiques.
Pour ce qui concerne les suites de ce plan, le groupe Breizh a-gleiz sera vigilant sur un certain nombre de points, certains seront exprimés tout à l’heure lors de la présentation :
Je vais mettre l’accent sur le plan attendu immobilier 2025-2027. Il y a des besoins criants à certains endroits. La contribution de l’Etat sur les bâtiments occupés par les CFA est incontournable. La mise en place du « dialogue d’investissement » est aussi une bonne chose tant les incompréhensions sur les choix de la région s’expriment.
Je vais citer 2 exemples qui ont fait l’objet de commentaires dubitatifs, dans les conseils d’administration, sur ce que conduit ou pas la région : comment comprendre le choix récent de travaux sur l’internat de Caulnes qui met de côté le travail sur l’enveloppe thermique, c’est-à-dire l’isolation du bâtiment, qui aurait pourtant pour conséquence la réduction de la facture énergétique ? Comment comprendre la région quand des élus locaux (et c’est d’ailleurs l’élue locale qui va l’exprimer) sont invités à des exigences fortes sur le plan thermique pour leur programmation de travaux de bâtiments s’ils veulent émarger aux crédits régionaux du programme Bien Vivre ?
2ème exemple : comment peut-on expliquer qu’il n’y ait toujours pas d’internat au lycée d’Hennebont, alors qu’il accueille des jeunes de 15 ans, dont les parents se retrouvent dans l’obligation de trouver un logement – rare et onéreux- dans un contexte de crise de logement, quand ils ne renoncent pas tout simplement à l’inscription de leur enfant, fragilisant un peu plus l’établissement qui se bat pour maintenir ses effectifs. Il va donc falloir s’emparer du sujet de l’internat pour ne pas condamner le site d’Hennebont, nécessaire pour préserver un maillage territorial.
L’enjeu est désormais de mettre en œuvre ce plan d’action. Les propositions y figurant, qui suscitent des attentes, ne peuvent pas rester lettre morte, et rien n’est pire qu’une concertation de façade.
Une clé est de garder un dialogue soutenu, au-delà des chefs d’établissements avec les équipes éducatives dans leur diversité et leur richesse et au plus près des besoins.
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
5 juillet 2025
5 juillet 2025
5 juillet 2025