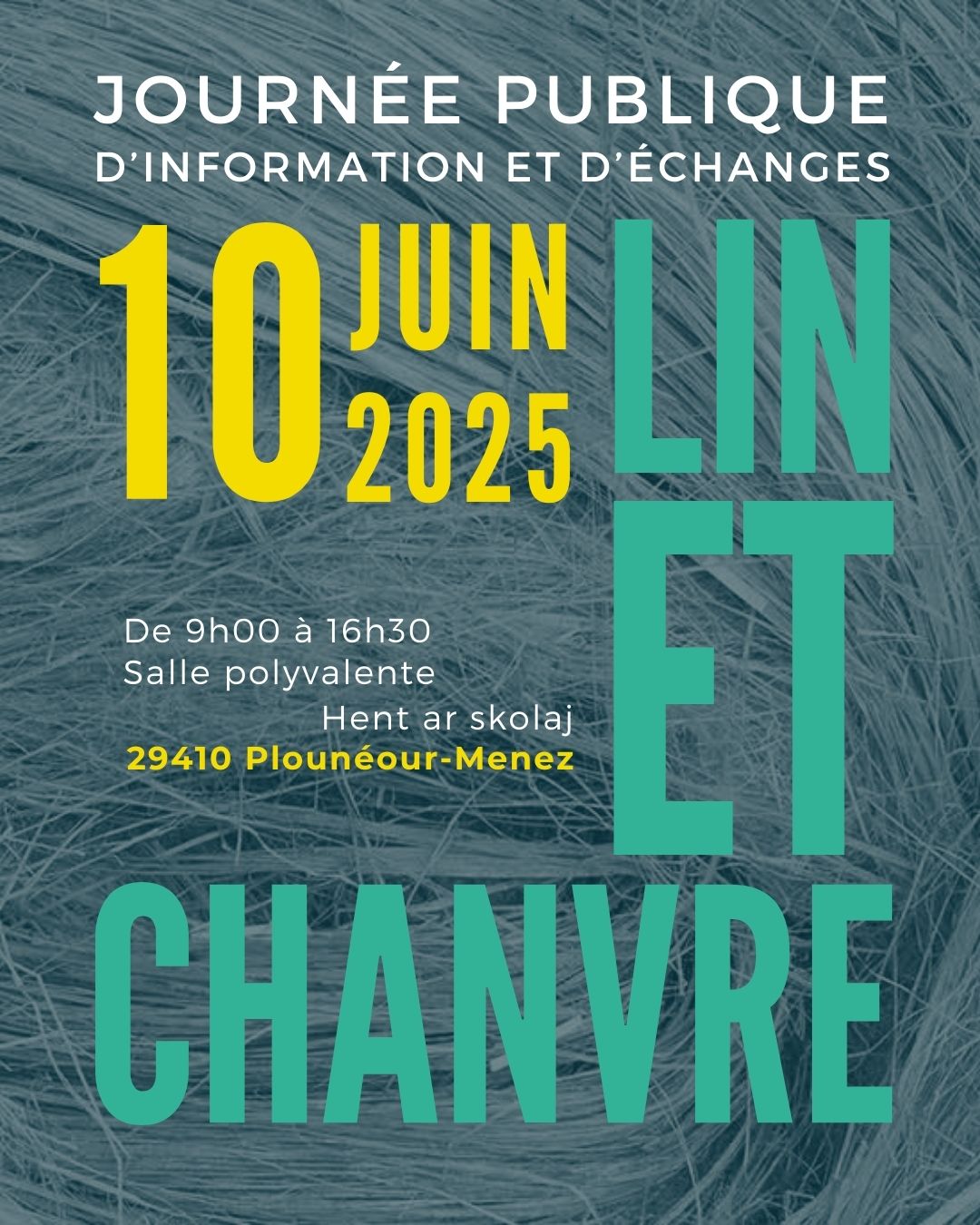Réindustrialisation de la Bretagne
Depuis le mois de mars 2020, un nouveau mot d’ordre s’est imposé dans notre pays : réindustrialisation !
Il était temps…
Il était temps, et l’on se pince un peu lorsque l’on se souvient comment les gouvernements français successifs – socialistes comme de droite – ont activement organisé la désindustrialisation de notre économie, au nom d’une vision soit disant «moderne» de la répartition de la valeur : à nous l’innovation et la matière grise, aux pays en développement la production manufacturière.
La prise de conscience de notre dépendance a été brutale, en mars 2020, et l’image emblématique en reste la pénurie de masques, du type de ceux qui étaient produits dans une usine bretonne, fermée un an avant la pandémie. Le second palier de cette prise de conscience, en février dernier, est arrivé comme un coup de tonnerre dans le ciel européen, lorsque l’Europe médusée a pris la pleine mesure de sa dépendance énergétique au pétrole, et surtout au gaz, d’une Russie hostile, qui venait de lancer ses chars contre l’Ukraine voisine.
Et donc nos dirigeants – et par dirigeants j’entends nos élu.e.s, nos hauts fonctionnaires (dont on connait le poids dans ce pays), mais aussi les dirigeants d’entreprises, qui ont leur part de responsabilité dans les délocalisations – nos dirigeants, donc, ont compris à quel point la restauration de la capacité industrielle des nations européennes est fondamentale, à plusieurs égards :
Pour des raisons de souveraineté, tant matérielle que stratégique.
Pour des raisons environnementales, tant la refonte des stratégies d’approvisionnement, le rapprochement entre lieu de production et lieu de consommation, est une clef de la lutte contre les émissions de GES.
Pour des raisons qui ont trait, aussi, à la cohésion sociale et territoriale : cf effet d’entrainement de l’industrie : emplois indirects (sous-traitants) + emplois induits (commerces, services, écoles, etc)
Que peut la Région Bretagne, me direz-vous, avec ses petits bras et son maigre budget, dans cette entreprise titanesque qui vise à renverser la vapeur de quatre décennies de désindustrialisation ? Et bien, elle peut au moins mobiliser l’ensemble des leviers à sa main, bouger ce qui peut l’être dans les interstices, et même s’aventurer hors des sentiers battus, sans attendre que se déploie d’en haut le grand plan de résilience tant attendu.
Les voies d’action ne manquent pas, dont certaines sont déjà bien identifiées par la Région. La commande publique en est une, car nous savons que pour reconstituer de véritables écosystèmes industriels, il faut structurer une demande à tous les échelons, de la commune jusqu’à la Région. Au passage, puisque j’évoquais les masques en introduction, soulignons que la Région a joué son rôle d’acheteur auprès de la Coop des masques, quand d’autres acteurs publics ont failli. On pourrait évoquer aussi l’animation de dynamiques de mutualisation entre des industriels qui travaillent encore trop peu ensemble, ou bien à l’échelle des bassins de vie. Sans oublier bien sûr le levier crucial de la planification : la révision de notre SRADDET sera l’heure de vérité quant à notre capacité à organiser la répartition spatiale des activités en intégrant pleinement le nouveau paradigme de finitude des ressources naturelles qui doit guider nos projections vers l’avenir.
Mais avant tout, chers collègues, il faut que nous soyons au clair sur le projet de société que servira cette réindustrialisation de la Bretagne que nous appelons de nos vœux. Car c’est bien ce projet de société qui fonde les politiques publiques. Selon que nous ferons le pari d’une société bretonne capable de renoncer à certaines de ses habitudes de consommation, ou bien, au contraire, désireuse de sauvegarder son mode de vie actuel ; selon que nous nous en remettrons au dynamisme des métropoles ou bien que nous porterons avec volontarisme un grand plan de revitalisation du Centre Bretagne, alors nous n’aurons pas les mêmes stratégies de réindustrialisation, nous ne miserons pas sur les mêmes filières, nous n’identifierons pas les mêmes actifs stratégiques.
Et parce qu’en matière politique, l’action est aussi parole, capacité à convaincre, à gagner des batailles intellectuelles, à embarquer les acteurs, permettez-moi d’insister sur un enjeu qui n’est pas anecdotique : celui de la mise en récit.
J’ai tenté de visualiser – mais je n’y suis pas parvenue – ce que vous entendiez, M. le Président, lorsque vous dites : « je veux les usines et l’écologie ». Non pas « les ouvriers et les paysans » (et pourquoi pas les partisans) ; non pas « les fonderies et les champs » ; mais cette image bancale : « les usines et l’écologie ». Et bien quand vous dites cela, M. le Président, vous reconduisez une dichotomie contre-productive, car ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une grande réconciliation. Nous préférerions vous entendre parler de « l’écologie DANS les usines », de tout ce dont sont capables nos industriels en matière d’éco-conception, de transformation des déchets en ressources, de recyclage. Car il est bien clair qu’une partie des solutions dont nous avons besoin dans cette transition écologique, énergétique, viendront de l’industrie (c’est un débat que nous avons régulièrement avec le maire de Saint Nazaire). Les solutions viendront de ces bâtiments rectangulaires, sortes de boîtes noires de nos cartes mentales d’illettrés de la production manufacturière, où subsistent des savoir-faire qui font qu’aujourd’hui, sur le territoire de Nantes-Saint Nazaire, nous avons la capacité d’usiner les pales de ces grandes éoliennes marines qui font pousser des cris d’orfraie aux élus de certains bancs de cette assemblée.
En bref, nous avons urgemment besoin de construire un nouvel imaginaire de l’industrie. Un imaginaire qui sorte des murs de l’usine pour nous amener à penser les synergies, les grandes infrastructures, les nouvelles alliances de la main et de la tête dont nous aurons besoin pour la grande transformation devant nous. Un imaginaire qui redonne ses lettres de noblesse aux métiers manuels, aux filières d’enseignement techniques. Un imaginaire qui nous permette de ré-intégrer l’industrie au cœur de nos projets de territoires, en particulier nos territoires ruraux, plutôt que de la refouler aux périphéries des agglomérations parce que nous ne la percevons plus que comme nuisance.
Un imaginaire, enfin, qui nous permette d’aller au bout des questions les plus difficiles, y compris pour les bancs auxquels j’appartiens : pouvons-nous nous satisfaire d’une délocalisation de notre responsabilité environnementale et sociale ? Faudra-t-il, demain, rouvrir des mines en Europe ? Mon collègue Kristian Guyonvarc’h avait porté il y a quelques temps une question orale qui formulait très bien le dilemme cornélien qui se pose à nous en matière d’exploitation du lithium, aujourd’hui indispensable à la fabrication des batteries qui nous offrent une alternative aux énergies fossiles.
Cette session aurait pu être l’occasion de commencer à tisser le canevas d’un nouvel imaginaire breton de la production et du travail, comme le CELIB l’avait fait en son temps. Le DOB aurait pu nous faire apercevoir les grandes inflexions stratégiques engagées par notre Région ; le SPASER, ou schéma des achats responsables, au-delà de sa qualité technique, aurait pu traduire une vision politique des articulations possible avec les dispositifs de développement économique nécessaires à la structuration de véritables filières industrielles ; le bordereau culture aurait pu – ou plutôt aurait dû – d’emblée faire une place à la Culture Scientifique Technique et Industrielle, tant les arts de faire sont une part intégrante de la culture au sens anthropologique du terme.
Pour conclure, nous espérons, M. le Président, que les réponses que vous apporterez à la question orale qui sera posée demain par Nil Caouissin seront claires, et de nature à impulser un grand débat, mobilisateur, courageux, sur le projet de société que la Région entend porter à travers ses choix en matière industrielle.
Partager cet article
Suivez-nous
Derniers articles
5 juillet 2025
5 juillet 2025
5 juillet 2025